




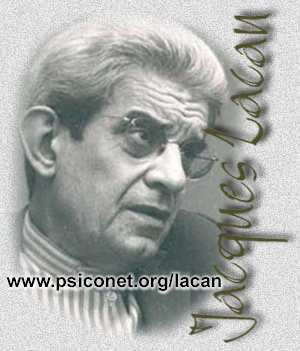
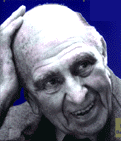

 | 
|  |
 |  | 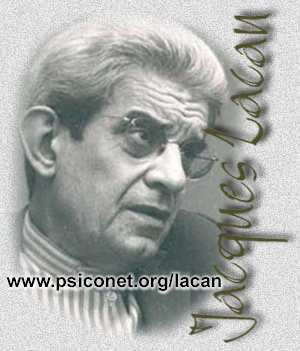 | 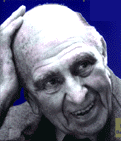 |  | ||||||
..Janet | ..Alexander | ..Bowlby | ..Cannon | .......Kandel | ......Edelman | ..James | Clérambault | .....Freud | ....Lacan | ...Lebovici | ....Klein | ...Jung | ...Bion |
|
Espace Cliniciens |
||||||
Dr Jean-Michel Thurin. Psychiatre -psychanalyste
Expert chargé des psychothérapies psychodynamiques pour le rapport
Tel : 01 48 04 77 70 – mail : jmthurin@techniques-psychotherapiques.org
Parmi les 94 articles qui composent la
bibliographie du chapitre 11 et qui m'ont été adressés
le 20 mars 2004 par le service de l'expertise collective de l'Inserm, il y a
quelques méta-analyses et une analyse des méta-analyse tout à
fait intéressante …
Il s'agit de l'étude de Georg E. Matt et Ana M Navarro.
Ce que les méta-analyses nous ont et ne nous ont pas appris à
propos des effets de la psychothérapie : revue et futures directions.
Matt G E, Navarro A M. What meta-analyses have and have not
taught us about psychotherapy effects: a review and future directions. Clin.
Psychol. Rev., Vol 17, n°1, 1997: pp 1-32
Durant les vingt dernières années, la méta-analyse est
devenue une technique populaire et méthodologiquement sophistiquée
pour réaliser une sommation quantitative des résultats issus d'un
corpus étendu de recherche "empirique". La recherche de résultat
sur la psychothérapie est des champs pour lesquels la méta-analyse
a été particulièrement populaire - mais également
où elle est apparue comme une méthode particulièrement
controversée. Le présent article fait la revue de plus de 60 méta-analyses
d'interventions psychothérapiques et examine leurs formes et leurs limitations
méthodologiques sur la base des inférences causales généralisables
qu'elles apportent à propos des effets des interventions psychothérapiques.
Les auteurs expliquent qu'en dépit du nombre important des méta-analyses
démontrant les effets spécifiques et non spécifiques des
interventions psychothérapiques, les limitations des études de
résultats et des revues actuelles de méta-analyses doivent nous
prévenir de tirer des conclusions généralisables sur l'ampleur
des effets, les conditions qui les modèrent et les variables qui modalisent
les effets de la thérapie.
Leurs démonstration s'appuie sur deux grandes catégories d'éléments : la nature et l'accumulation des biais méthodologiques dans les résultats ; la généralisation abusive de ces résultats.
1. L'idée générale sur laquelle s'appuie la force de la
méta-analyse est que le nombre important d'études va annuler
l'effet des biais présents dans les études primaires. Rien
n'est moins sûr.
- Il y a notamment le problème des données manquantes (dans
18 des 63 méta-analyses) qui peut biaiser les estimations de tailles
d'effet dans les méta-analyses. Une solution utilisée quelque
fois dans ces cas (outre le fait d'essayer de les obtenir des auteurs) est d'associer
à ces absences un effet 0. Dans ces cas, la taille d'effet globale peut
être réduite pratiquement du quart (Shapiro et Shapiro, 1980).
- Le codage des informations concernant les patients, les interventions,
le cadre, les résultats et la conception de la recherche n'était
pas clair dans environ 1/3 des méta-analyses.
- La réduction des mesures à celles d'un comportement cible,
plutôt que sur un ensemble de comportements, augmente la taille d'effet
de l'intervention. De façon plus générale, l'absence de
règle précise sur la sélection des mesures de résultats
peut conduire à des biais d'extraction (on ne garde que les mesures qui
donnent de bons résultats). Le mélange des tailles d'effet dans
une valeur globale moyenne peut négliger l'effet de l'effet de certaines
variables sur d'autres qui leur sont dépendantes.
- Le choix des groupes de contrôle est évidemment important.
Ainsi, l'effet placebo d'une liste d'attente sera moins important que celui
d'une intervention impliquant des composants non spécifiques. L'influence
des facteurs spécifiques devrait mieux apparaître dans la comparaison
de deux thérapies véritables. On arrive ainsi à des différences
de taille d'effet de 0.87 en comparant des groupes de traitement à une
liste d'attente et de 0.64 en comparant les groupes de traitement
à des groupes d'attention placebo.
- Des effets de confusion peuvent provenir du fait que les différentes
thérapies peuvent obtenir des effets différents suivant la sévérité
des troubles. Par exemple Andrew et Harvey (1981) ont trouvé que
les psychothérapies dynamiques et comportementales traitaient des troubles
plus sévères, tandis que les approches de conseil traitaient des
problèmes moins sévères.
- Une autre confusion provient de la relation de quasi exclusivité
qui peut s'établir entre une approche psychothérapique et certains
troubles. Ainsi, l'impulsivité, l'hyperactivité, les phobies
et certains problèmes somatiques n'ont été étudiés
pratiquement que par les thérapies comportementales ou la relaxation.
Certaines techniques n'ont été étudiées que dans
des cadres particuliers (par exemple, la méditation dans les prisons).
- L'allégeance des chercheurs à une intervention particulière
a été identifiée comme variable de confusion dans les études
sur l'efficacité de la thérapie cognitive et de la désensibilisation
systématique (Berman et coll., 1985).
- Il y a également les effets pervers d'une généralisation
accrue : "Là où des études de résultat
individuelles nous informent à propos des effets d'interventions spécifiques,
chez des échantillons de patients spécifiques, dans des
cadres spécifiques, concernant des mesures spécifiques,
la méta-analyse nous enseigne à propos d'effets généralisés
de classes d'interventions, chez des classes de patients, des
classes de cadre et des classes de mesures".
Autrement dit, on tire des conclusions générales - et souvent
généralisées - à partir d'un ensemble d'études
dont les caractéristiques élémentaires et les déséquilibres
généraux (cf, par exemple la méta-analyse
de Andrews et Harvey) se sont totalement masqués.
Les limites associées à chacune des études qui ont été
pratiquées dans des conditions particulières ne permettent pas
de répondre à une question globale telle que: "Quels thérapeutes,
pour quels types de traitements psychothérapiques, pour quelle sorte
de patient produisent quelles sortes d'effets perçus à la fois
immédiatement et ultérieurement ?" (Fiske, 1977 ; Paul, 1969,
…".
- D'autres limites générales devraient être prises en compte.
Par exemple l'époque durant laquelle les études ont été
menées, notammentsi elle conditionne le cadre thérapeutique. Les
effets de la psychothérapie observés durant les années
70 et 80 sont-ils généralisables à des cadres de pratique
clinique actuels pour lesquels peu de recherche de résultat a été
publiée. Il faudrait alors pouvoir définir les variables intermédiaires
qui interviennent sur l'effet et considérer si elles se retrouvent dans
les différentes périodes considérées [un bon exemple
est celui de la fameuse seule et unique étude sur la schizophrénie
retenue par la Cochrane et qui date de 1976 : non seulement les conditions générales
ont considérablement changé en près de 30 ans, mais cette
étude ne renseigne en rien sur les modalités de l'approche et
du cadre psychothérapique mis en oeuvre]. Le facteur langue et culture
est également important. Dans quelle mesure les résultats des
études anglo-saxones sont-ils généralisables à l'Europe
du sud, au Japon ou à l'Amérique du sud. L'association des deux
facteurs précédents est évidemment redoutable.
Il existe encore beaucoup d'autres raisons d'être circonspect sur la
valeur des résultats et de leur généralisation.
Par exemple, Il existe un grand nombre d'études primaires comparant les
effets de la psychothérapie à ceux d'une absence de traitement.
La plupart de ces études - mais certainement pas toutes - impliquent
de jeunes patients, étudiants de collège et examinent les effets
d'une ou plusieurs interventions thérapeutiques spécifiques dans
des cadres universitaires. Bien que ces études soient comparables à
différents égards, il existe une variabilité considérable
dans les conceptions de recherche, les mesures et la documentation.
Souvent également les estimations des effets des interventions psychothérapiques
sont confondus avec d'autres caractéristiques de l'étude (par
exemple la réactivité de la mesure), ce qui rend l'interprétation
des effets du traitement ambigue.
Finalement, selon Matt et Navarro, la seule conclusion qui pourrait être véritablement tirée de ces 63 méta-analyses est l'affirmation que l'effet psychothérapique est différent de 0 et positif, mais qu'il est difficile d'aller plus loin sur l'amplitude des effets.
Quelles devraient être les directions futures de la recherche ?
Un des grands enjeux concerne l'efficacité réelle de la psychothérapie, telle qu'elle est prodiguée dans la pratique clinique quotidienne (c'est à dire les centres de soin communautaires, la pratique privée). Cela se situe en contraste avec l'efficacité de la psychothérapie étudiée dans des conditions scientifiques standards avec de populations ciblées.
Il est également nécessaire d'avoir des rapports plus détaillés des études primaires. Un pas essentiel serait l'établissement d'un registre de recherche des études de résultats de la psychothérapie. La sophistication de la qualité des méta-analyse par la participation de méthodologistes expérimentés dans ce domaine est nécessaire.
La conclusion de tout cela reste celle de la prudence. La méta-analyse n'est pas la panacée de la synthèse des résultats de recherche. La méta-analyse parfaite donnant des réponses sans équivoque à des questions de recherche est aussi improbable qu'une recherche primaire parfaite.
Qu'a retenu l'auteur du chapitre 11 de cet article article de Matt et Navarro dont j'ai essayé de présenter l'esprit d'analyse et la complexité ? Une phrase très simple que, je dois le reconnaître, je n'ai même pas remarquée malgré une lecture qui m'a parue attentive : "montrent typiquement la supériorité des approches cognitives et comportementales en comparaison avec les approches psychodynamique ou rogerienne".
Il fallait vraiment le trouver !
2. Expertise collective Inserm Psychothérapie, p 381-427
Dernière mise à jour : 22/11/04
info@techniques-psychotherapiques.org

| 
|