




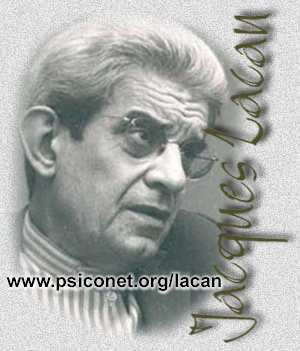
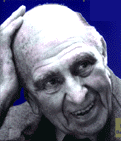

 | 
|  |
 |  | 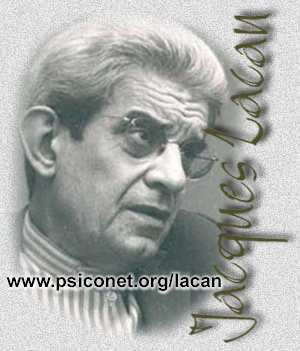 | 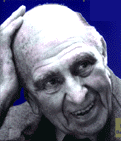 |  | ||||||
..Janet | ..Alexander | ..Bowlby | ..Cannon | .......Kandel | ......Edelman | ..James | Clérambault | .....Freud | ....Lacan | ...Lebovici | ....Klein | ...Jung | ...Bion |
|
Espace Cliniciens |
||||||
Dr Jean-Michel Thurin. Psychiatre -psychanalyste
Expert chargé des psychothérapies psychodynamiques pour le rapport
Tel : 01 48 04 77 70 – mail : jmthurin@techniques-psychotherapiques.org
Ça y est. Je viens de recevoir (20 mars 2004) les 94 articles qui composent
la bibliographie du chapitre 11. Tout du moins ceux cités en possession
du service de l'expertise collective de l'Inserm.
Un premier parcours des bases et conclusions principales des auteurs des 25 premiers articles fait apparaître dès à présent trois points : 1) beaucoup d'études "comparatives" ne concernent de fait que les TCC (10/25) - 2) celles qui comparent les TCC et les psychothérapies psychodynamiques (5/25), ne montrent pas ou très peu de différence de résultats entre les méthodes. - 3) les auteurs des différents articles recommandent de façon permanente un abord plus précis que celui des comparaisons "globales" et font de nombreuses recommandations sur ce que peut être une étude comparative intéressante. Comment se fait-il que cet avis (qui revient en permanence depuis une quinzaine d'années) n'ait pas été pris en compte pour cet expertise ?
On peut souligner les éléments de quelques conclusions :
Celles de la méta-analyse d'études comparatives de
Shapiro et Shapiro (1982)
(1) l'impact moyen des traitements psychologiques dans la recherche récente
approche une déviation standard de 1.
(2) les différences modestes sont largement indépendantes d'autres
facteurs influençant le résultat.
(3) la recherche contemporaine de résultat n'est pas représentative
de la pratique clinique.
Celles de la méta-analyse de
Shadish et col. (2000) sur les effets des thérapies psychologiques
dans des conditions cliniques représentatives :
1) les thérapies psychologiques sont efficaces de façon robuste
dans des conditions qui vont de l'orientation recherche à la clinique
;
2) les résultats antérieurs suivant lesquels la représentativité
clinique conduit à une taille d'effet plus faible sont probablement un
artefact d'autres variables confondues, en particulier le biais d'auto-sélection
dans le traitement dans de nombreuses études quasi-expérimentales
qui arrivent à être cliniquement représentatives ;
3) une dose accrue de thérapie est associée à un meilleur
résultat, bien qu'il semble probable que le niveau de bénéfice
puisse plafonner à un certain point ;
4) les études tendent à montrer des effets plus importants si
elles évaluent le résultat en utilisant des mesures qui sont étroitement
taillées pour les buts qui sont visés dans le traitement (de façon
similaire à l'effet "d'enseigner le test" de la recherche en
éducation). [cela est évidemment important dans le cadre d'une
approche très "cocorico" des études comparatives où
une très légère supériorité de la taille
d'effet trouvée avec un instrument particulier de mesure de la dépression
(par exemple, la BDI) et non retrouvée avec un autre est néanmoins
appréhendée comme une importante victoire …!]
L'étude de Shapiro et col. (1994), comparant les effets de la durée du traitement et de la sévérité de la dépression sur l'efficacité réelle de la TCC et de la psychothérapie psychodynamique interpersonnelle, est particulièrement intéressante.
Elle présente d'abord les biais potentiels des études comparatives
et la façon de les éviter :
- La puissance des études pour détecter les différences
liées au traitement dépend de l'adéquation des tailles
d'échantillons, de la délivrance des traitements telle qu'elle
est spécifiée, du contrôle des effets thérapeute
et de l'usage de mesures appropriées au trouble et aux objectifs de chaque
méthode thérapeutique.
- L'allégeance de l'investigateur, qui peut être inférée
de façon sûre à partir de la façon suivant laquelle
chaque étude est rapportée devrait être contrôlée
statistiquement pour rapporter une estimation vraie de l'efficience comparative.Une
autre solution est d'établir un équilibre entre les positions
de référence des différents chercheurs participant à
une même étude.
- Il est également essentiel de veiller à ce que le traitement
de comparaison soit réalisé d'une façon qui soit représentative
(comparaison à des pseudo-traitements).
- La sévérité du trouble devrait être systématiquement
précisée.
- La durée du traitement et le moment où l'évaluation post-traitement
est faite devraient être pris en compte.
- La différence des résultats peut être dûe au choix
des mesures effectuées qui correspondent plus ou moins aux objectifs
de la psychothérapie. Dans leur étude, Shapiro et col. ont associé
aux mesures de symptômes l'Inventaire des problèmes interpersonnels
d'Horowitz.
En respectant ces recommandations méthodologiques :
1) Contrairement à ce qui est habituellement proclamé, la TCC
n'est pas plus efficace que la psychothérapie interpersonnelle psychodynamique
2) Il n'existe pas d'élément convaincant suivant lequel la focalisation
plus spécifique de la TCC sur le symptôme conduirait à des
effets plus rapides
3) Il n'y a pas d'évidence convaincante d'une réponse différentielle
des deux traitements en fonction de la sévérité initiale
de la dépression
4) Il existe une faible évidence suivant laquelle une psychothérapie
de 16 séances est plus efficace qu'une thérapie de 8 séances.
Plus exactement, la durée plus longue est efficace pour les dépressions
sévères. Ces résultats, qui concordent avec ceux d'Elkin
et col. (1989) doivent mettre en garde contre la généralisation
des effets thérapeutiques à l'éventail de la sévérité
de la dépression. Les dépressions sévères (BDI dans
les hauts des 20 et supérieurs) peuvent répondre de façon
tout à fait différente à la psychothérapie que des
troubles plus légers dans des études analogues. Cela renforce
le besoin identifié par Hollon et col. (1993) d'un travail supplémentaire
comparant la thérapie cognitive avec d'autres traitements psychosociaux
effectués dans des populations cliniquement représentatives.
Les recommandations de Shapiro et col. (1994) pour les recherches ultérieures
sont les suivantes :
- étudier les interactions entre les caractéristiques des patients
et la méthode thérapeutique (Beutler, 1991 ; Shoham-Salomon et
Hannah (1991)
- les études comparatives ultérieures de traitements de la dépression
doivent inclure l'examen concomitant des processus de changement (Garfield,
1990 ; Greenberg, 1991 ; Marmar, 1990 ; Stiles et coll., 1988) dans les traitements
comparés. Les chercheurs devraient se concentrer sur la délimitaton
des mécanismes sous-tendant le changement pour déterminer lesquels
sont communs aux différents traitements et lesquels sont spécifiques
d'une méthode donnée.
Comment cette étude très intéressante, et en particulier
ses résultats, sont-ils présentés par le rédacteur
du chapitre XI ? Par la phrase suivante, perdue au centre de la page 402 :
"Les deux autres études de haute qualité méthodologique,
Shapiro et coll. (1994) et Hardy et coll. (1998), font partie du même
programme de recherche, partageant les mêmes échantillons et la
même méthodologie. Ces investigations diffèrent de la majorité
d'autres études contrôlées du fait que tous les thérapeutes
ont administré les deux thérapies et ont déclaré
les croire également efficaces. Ces auteurs notent que les effets positifs
de la TCC étaient particulièrement observables pour la dépression
modérée ou pour les patients atteints de certaines formes de troubles
de personnalité comorbide"
… … …
2. Expertise collective
Inserm Psychothérapie, p 381
Dernière mise à jour : 17/11/04
info@techniques-psychotherapiques.org

| 
|